Société
Societé: Niger : Revoir notre rapport au travail : une urgence pour faire décoller le pays !
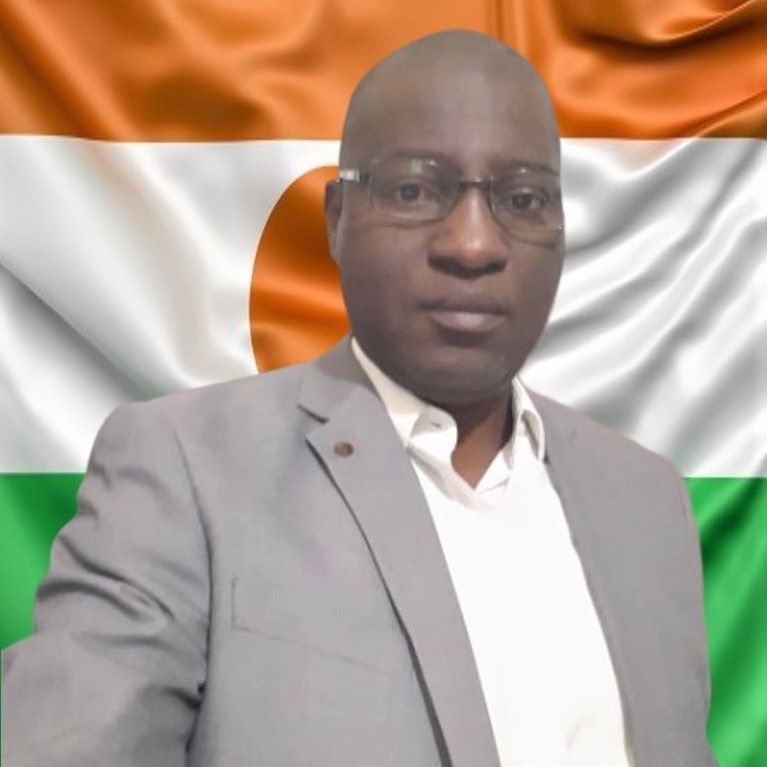
Le travail, pierre angulaire du progrès humain, semble avoir perdu sa valeur dans notre société. Pourtant et c’est connu de tous, aucune nation ne peut aspirer à se développer sans un respect profond pour cette vertu essentielle. Au Niger, les germes de notre sous-développement se nourrissent, entre autres, d’un rapport au travail dévoyé et d’une tendance alarmante à privilégier l’assistance, les raccourcis, et les privilèges immérités. Si nous ne changeons pas radicalement cette mentalité, nos aspirations au progrès risquent de rester des chimères pour longtemps encore.
Le travail méprisé, le mérite galvaudé
Un des points de bascule historique pour notre pays a été l’ère de la « démocratie », inaugurée au sortir de la Conférence Nationale Souveraine. Cette période, bien que marquante pour l’enracinement des valeurs dites « démocratiques », a bouleversé le rapport au mérite. L’administration publique, autrefois sanctuaire des valeurs de rigueur et d’intégrité sous Kounché, est devenue un terrain de jeu où les nominations sont dictées par les appartenances politiques et les accointances claniques plutôt que par les compétences et le travail acharné. Il est dès lors devenu courant de voir des cadres promus à de hautes fonctions sans jamais avoir fait preuve d’un quelconque mérite professionnel. Cette situation a non seulement sapé la motivation des travailleurs intègres, mais elle a aussi érigé en modèle une culture où le travail n’est plus un levier d’ascension sociale.
L’administration publique est devenue peu performante et incapable de répondre aux besoins des citoyens. Comment alors espérer le progrès si ceux qui doivent être les moteurs sont eux-mêmes les produits d’un système qui récompense la médiocrité et l’appartenance clientéliste ?
La quête du gain facile : une gangrène sociale
La mendicité est un autre exemple qui illustre notre rapport malsain au travail. Certes, cette pratique trouve ses racines dans des réalités économiques et sociales difficiles. Cependant, elle est devenue pour certains une stratégie délibérée pour éviter les efforts nécessaires à une vie décente. Dans nos rues, des adultes en bonne santé, capables de travailler, préfèrent tendre la main que de se lever tôt pour subvenir à leurs besoins. Cela ne peut qu’affaiblir l’éthique du travail dans notre société et propager l’idée qu’il est acceptable de vivre aux dépens des autres.
De même, la prolifération des marabouts et des charlatans dans nos villes et villages démontre une volonté croissante de contourner l’effort. Certains d’entre eux, sous le couvert de la religion, prospèrent sur les désirs de citoyens prêts à tout pour réussir sans fournir de labeur. Ceux qui les consultent espèrent des miracles : des promotions au travail, des richesses instantanées ou des succès sans mérite. Cette quête de raccourcis sape profondément les fondements de notre société.
Les illusions de la dépendance : le cas de certaines femmes
Dans les milieux urbains et dans certaines campagnes, une grande partie de la gent féminine attend souvent qu’un mari généreux prenne en charge leurs besoins et ceux de leurs familles. Cette mentalité, issue de certains aspects de notre culture, limite le potentiel énorme que représente la participation des femmes à l’économie. Au lieu de valoriser leurs compétences et de contribuer activement à la société, certaines se contentent de miser sur leur charme pour subvenir à leurs besoins. Pourtant, les femmes nigériennes, comme ailleurs, ont démontré qu’elles pouvaient exceller lorsqu’elles s’investissent dans le travail productif.
Repenser notre avenir : vers une révolution socio-culturelle
Pour amorcer un véritable décollage, le Niger doit revoir son rapport au travail. Ce changement commence par une réforme en profondeur de nos institutions pour rétablir la valeur du mérite. Les promotions dans les hautes fonctions de l’Etat doivent être basées sur les compétences et les performances, et non sur certaines considérations complaisantes. Il faut instaurer une culture de l’évaluation et de la reddition des comptes à tous les niveaux.
En parallèle, il est impératif de valoriser les métiers manuels et agricoles, qui restent souvent dépréciés. L’entrepreneuriat doit être encouragé, surtout parmi les jeunes, avec des politiques incitatives et un meilleur accès aux financements.
Enfin, nous devons mener une véritable campagne de sensibilisation pour réhabiliter le travail comme un vecteur d’épanouissement personnel et de transformation sociale. Cela implique de combattre les pratiques de mendicité, de lutter contre les illusions des marabouts, et de promouvoir l’émancipation économique des femmes.
Le développement du Niger ne pourra se faire sans une transformation radicale de notre société. Nous devons réapprendre à valoriser le travail et à récompenser le mérite. La recherche de raccourcis, l’assistance, et la dépendance ne feront que prolonger notre retard. Relever ce défi demande une prise de conscience collective.
Travaillons avec ardeur et intégrité, car c’est par la sueur de nos fronts que nous pourrons bâtir un Niger prospère.
Chronique hebdomadaire du Mercredi 1er Janvier 2025 signé Kafiniger
Mahamadoulkafi Djibrilla est Docteur en soins infirmiers, il est aussi Analyste, Chroniqueur, Chercheur Indépendant et blogueur. Constamment, il se prononce sur les grandes préoccupations du moment. Ses analyses abordent les enjeux et défis liés au contexte actuel de notre pays, et au-delà les pays de l’Alliance des Etats du Sahel.
Société
Approche communautaire participative intégrée : la stratégie de l’ONG Garkua au Niger
Depuis 2016, l’ONG Garkua accompagne les communautés nigériennes dans un développement durable et inclusif. Face aux défis humanitaires, économiques et sociaux, l’organisation mise sur une approche intégrée combinant aide d’urgence, projets de développement et renforcement de la cohésion sociale. Sani Mourtalla, son secrétaire permanent, nous partage les stratégies et défis de cette mission essentielle au Niger.

Originaire de Zinder, Sani Mourtalla est ingénieur agronome de formation. Cela fait près de 20 ans qu’il travaille dans le secteur des ONG nationales et internationales au Niger. Depuis 2018, il est secrétaire permanent de l’ONG Garkua.
Présentez-nous l’ONG Garkua. Sur quelles problématiques travaillez-vous?
L’association nigérienne pour un développement durable (ou Garkua qui veut dire “protection” en langue nationale) est une ONG de droit nigérien créée en 2016 par des acteurs de développement du Niger. L’objectif est d’appuyer les communautés à faire face aux différents défis qui se présentent.
Nous travaillons dans 3 secteurs :
- Humanitaire, à travers des réponses aux catastrophes naturelles (inondations, sécheresses, etc.) et aux crises alimentaires.
- Développement, en appuyant les communautés à améliorer leur production agricole et l’élevage afin de réduire la pauvreté, en fournissant des services sociaux de base à travers la réalisation d’infrastructures scolaires, de santé, hydrauliques et bien d’autres types d’infrastructures.
- Renforcement de la cohésion sociale, à travers des programmes de stabilisation mis en œuvre dans les régions fragiles du Niger, notamment Agadez, Diffa et Tillabéry.
Quels sont les facteurs de réussite pour pouvoir travailler sur ces trois secteurs : humanitaire, paix et développement ? Est-ce un exercice complexe ? Comment vous y prenez-vous pour établir un continuum entre ces trois dimensions ?
Les zones dans lesquelles nous intervenons au Niger font continuellement face à ces trois défis, donc travailler sur un seul secteur ne permet pas de répondre aux besoins des communautés et ne permet pas d’avoir les résultats escomptés. Cela nous pousse à embrasser les différents secteurs – humanitaire, développement et paix – pour avoir de l’impact.

Les besoins humanitaires sont des besoins ponctuels se présentant à des périodes définies de l’année. Dans notre réponse à ces besoins, nous jetons les bases des actions de développement. Par exemple, en cas de crise alimentaire ou d’inondations, nous menons des actions de « cash for work » pour restaurer des terres dégradées. Les communautés reçoivent ainsi de l’argent pour répondre à leurs besoins immédiats (nourriture, santé, ressources pour financer la scolarité de leurs enfants) et en même temps, nous réhabilitons l’écosystème et les terres dégradées qui seront mises en valeur par ces communautés pour produire plus les prochaines années.
Nous veillons aussi à ce qu’il y ait une bonne inclusion dans toutes nos activités, que personne ne soit laissé pour compte. Cette approche permet de réduire les inégalités au niveau communautaire, car celles-ci sont en grande partie sources de conflits.
Dans la construction de ponts entre humanitaire, développement et paix, êtes-vous suffisamment soutenu par les bailleurs de fonds?
Beaucoup de partenaires nous soutiennent dans ce sens. Nous recevons des financements multisectoriels, dans lesquels nous avons des actions d’urgence, de développement et de renforcement de la cohésion sociale.
D’autre part, nous ne sommes pas seuls au niveau des communautés avec lesquelles nous travaillons : nous cherchons à créer des connexions avec les acteurs humanitaires et de développement pour apporter une réponse appropriée.
Quelles sont, selon vous, les bonnes pratiques qui méritent d’être répliquées pour des interventions dans les zones fragiles au service des besoins des populations?
Les approches communautaires participatives intégrées sont, pour nous, une bonne pratique. Nous avons développé cette approche qui responsabilise les communautés locales et les autorités locales pour prendre en charge leur propre développement. Cette approche participative communautaire intégrée a été développée avec plusieurs partenaires, dont le BMZ et l’UNICEF. Elle donne le pouvoir aux communautés.
Chaque village où nous intervenons dispose d’un plan d’action villageois et d’un comité villageois qui assure sa mise en œuvre et le suivi de la planification. Au niveau de la commune, nous avons ce que nous appelons la « plateforme communale d’engagement communautaire » qui est une émanation des comités villageois qui se réunissent au niveau communal. Cette structuration permet d’autonomiser les communautés dans la mise en œuvre des actions de développement au niveau communautaire, même si la zone est difficile d’accès pour les partenaires (ONG, acteurs de l’État, etc.). Une grande partie des activités du plan communautaire réalisé au niveau des villages peuvent être mises en œuvre par la communauté elle-même, sans avoir besoin de financement extérieur. C’est ce que nous faisons dans les zones fragiles pour assurer la continuité des actions de développement. D’autre part, dans les zones où nous n’avons pas développé cette approche, nous avons les relais communautaires qui sont des animateurs endogènes au niveau des villages, qui peuvent continuer à mettre en œuvre les activités même si l’accès est difficile pour les ONG.
À quels défis êtes-vous confronté pour accompagner les communautés dans leurs perspectives d’une vie meilleure?
Le premier défi, ce sont les ressources limitées. Le Niger est très vaste, il y a 265 communes avec des dizaines de milliers de villages. Les besoins sont énormes et les financements sont de plus en plus rares.
Le second défi, c’est l’accès. Depuis un certain temps, l’accès à certaines communautés, à certaines zones fragiles est difficile. Bien que nous ayons mis en place des stratégies permettant aux communautés de continuer à assurer les activités de développement, ce défi persiste.

Le troisième défi, c’est en termes de capacité des communautés à pouvoir s’approprier les stratégies que nous sommes en train de développer. Avec un taux de scolarisation très faible au niveau rural, il y a des villages dans lesquels pratiquement personne ne sait écrire. Cela complique l’assimilation de ce qui est en train d’être mis en place pour le développement dans certaines communautés.
Pourriez-vous nous en dire plus sur la coordination entre les différents acteurs du développement et de l’humanitaire dans les zones fragiles. Comment faites-vous pour avancer ensemble de manière efficace?
Beaucoup reste à faire pour une meilleure coordination entre les partenaires. Nous participons à plusieurs cadres de concertation, notamment via les clusters thématiques coordonnés par OCHA.
Au niveau régional et communal, il existe des cadres de concertation pour réunir les partenaires qui interviennent dans une même région ou commune.
Là où nous intervenons avec l’ONG Garkua, nous appuyons les communes à rendre ce cadre de concertation fonctionnel. En effet, nous sommes convaincus que le niveau le plus pertinent pour la coordination, c’est le niveau communal. Des réunions périodiques sont organisées avec tous les acteurs, autour des autorités communales, pour partager les planifications.
Nous sommes même en train de faire en sorte qu’il y ait des planifications conjointes au niveau communal. Tous les partenaires intervenant dans une commune se retrouvent en début d’année pour faire une planification conjointe, permettant d’assurer la cohérence en termes de nexus humanitaire, développement et paix. Cela permet également d’éviter la duplication d’activités ou d’avoir des besoins non couverts.
Quelles recommandations feriez-vous pour que la société civile et les ONG s’impliquent davantage dans la mise en œuvre de l’approche territoriale intégrée portée par l’Alliance Sahel?
L’approche territoriale intégrée est une approche très louable. Ma première recommandation, c’est de créer un comité de pilotage pour faire en sorte que tous les acteurs de la décentralisation soient impliqués dans ce processus. Il s’agirait de créer un cadre où tous les acteurs de la décentralisation se trouvent autour de la stratégie de l’approche territoriale intégrée.

La seconde chose, c’est d’impliquer davantage la société civile puisqu’elle est au plus proche des communautés. Au sein de l’ONG Garkua, nous collaborons avec les organisations de la société civile pour qu’elles puissent sensibiliser les communautés et les autorités locales à l’approche territoriale intégrée. L’objectif est de leur permettre de mieux comprendre cette approche, de saisir les enjeux et de s’impliquer activement dans sa mise en œuvre.
La troisième recommandation, c’est l’alignement puisque, dans le cadre de l’approche communautaire participative intégrée que nous mettons en œuvre, tous les villages dans lesquels nous intervenons ont un plan d’action qui sert de base à l’élaboration des plans de développement communaux. Il faudrait que tous les acteurs qui interviennent sur le terrain s’alignent sur les plans de développement communal et villageois.
Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus au niveau de la collaboration avec la Facilité Sahel? Quelles sont les activités mises en place avec leur soutien? Est-ce que leur appui vous amène à mettre en œuvre une approche un peu différente?
L’ONG Garkua est bénéficiaire d’un financement de 6 millions d’euros de la Facilité Sahel pour la mise en place d’un projet que nous appelons : « Projet d’appui à la stabilité socio-économique et à la paix », dans 4 communes de la région de Tillabéry.
Ce projet touche 3 thématiques essentielles :
- La promotion de services sociaux de base: réalisation d’infrastructures hydrauliques, de santé et éducatives ;
- La promotion des moyens d’existence: amélioration de la production agricole, des pratiques d’élevage, restauration des écosystèmes ;
- La promotion de la paix et de la cohésion sociale à travers le renforcement des liens entre les communautés et des activités de socialisation au niveau des communautés.
Ce projet est essentiellement basé sur l’approche communautaire participative intégrée. Nous travaillons sur la planification communautaire, qui est une déclinaison de la planification communale. Tout ce que nous allons réaliser doit émaner de celle-ci. Ce projet est en droite ligne avec l’approche territoriale intégrée de l’Alliance Sahel, qui veut que la commune et les communautés soient responsabilisés pour les actions qui les concernent.
Personnellement, qu’est-ce qui vous motive et vous donne espoir dans votre travail avec les communautés au Niger?
Ce qui me motive, c’est que les communautés ont des capacités extraordinaires. Cela me donne envie de poursuivre le travail avec elles, pour aboutir à des résultats extraordinaires. La grosse erreur que les acteurs de développement font, c’est de considérer que les communautés sont des bénéficiaires. Nous considérons les communautés comme des partenaires et nous sommes en train d’engranger des résultats extraordinaires en nous basant sur les capacités locales.

La deuxième chose qui me motive, c’est la jeunesse. Plus de 70% de la population rencontrée dans les villages sont des jeunes. Nous devons développer la capacité de cette jeunesse pour qu’elle puisse être l’avenir de notre pays. Si on la laisse dans la situation où elle est, elle peut constituer un problème à long terme pour le pays. Cela me motive à poursuivre le travail au sein des communautés pour renforcer les capacités de ces jeunes, leur offrir des opportunités de formation ou d’emploi afin qu’ils puissent devenir des acteurs de développement, mais aussi pour qu’ils puissent participer à la gouvernance locale de leur communauté.
Source: Alliance Sahel (https://www.alliance-sahel.org/actualites/approche-communautaire-participative-integree-strategie-ong-garkua-niger/?
Société
Rupture collective de jeûne à l’ONAHA : Union, convivialité et partage entre le Directeur Général et les agents

Le jeudi 20 mars 2025, l’ensemble du personnel de l’office national des aménagements hydro agricole (ONAHA), s’est retrouvé autour du Directeur général le Lieutenant-Colonel Bilaly Elhadj Gambobo pour une rupture collective de jeûne à l’occasion de ce mois béni de ramadan. Organisée pour la première fois à l’ONAHA, cette retrouvaille désormais inscrite dans la tradition de cette institution vise à rapprocher davantage les agents de leur administration.

Dans la communion des cœurs, la convivialité et le partage connus des fidèles musulmans, les agents de l’office national des aménagements hydro agricole (ONAHA) ont rompu dans la joie et la symbiose avec le premier responsable de cette institution. Conformément aux préceptes de l’islam, l’initiative de l’administration générale sous la conduite du Directeur Général le Lieutenant-Colonel Bilaly Elhadj Gambobo consiste à profiter de ce temps important pour passer des moments d’échanges, d’affection, de partage et de cohésion entre l’ensemble des agents.
Comme le veut la tradition musulmane, après la rupture de jeûne, le Directeur Général le Lieutenant-Colonel Bilaly Elhadj Gambobo et les agents se sont retrouvés à la mosquée pour la prière du Maghreb. Occasion aussi de prier pour le pays afin que Dieu, le tout puissant protège notre pays et ses dirigeants et qu’il descente sa clémence et la prospérité au Niger.

Un moment également pour l’administration d’encourager les agents pour les efforts déployés au quotidien pour la bonne marche du travail. A leur tour, les agents de l’ONAHA ont remercié le Directeur Général le Lieutenant-Colonel Bilaly Elhadj Gambobo pour sa vision et sa façon de conduire l’institution. « Depuis sa nomination à la tête de l’ONAHA, il ne cesse de nous surprendre à travers des initiatives qui visent à rassembler les agents ensemble. Cela nous donne beaucoup plus de motivation et d’engagement pour le travail » a indiqué un délégué du personnel. Ce dernier a aussi précisé : « Aujourd’hui, cette rupture collective s’ajoute déjà aux autres initiatives où les agents se retrouvent autour des activités sportives, ils organisent de séance de salubrité pour rendre les lieux de travail propre ».

Depuis sa nomination à la tête de l’ONAHA, le Lieutenant-Colonel Bilaly Elhadj Gambobo montre chaque fois qu’il mérite la confiance placée en lui par les plus hautes autorités de notre pays. Il conduit bien sa mission de faire de l’ONAHA un outil pour accompagner l’Etat vers un objectif de 80% de l’autosuffisance alimentaire, d’ici 2027.
-

 Santé3 mois ago
Santé3 mois agoGestion de l’abattoir frigorifique de Niamey : Le Conseil d’Administration tient sa 88eme session ordinaire
-

 Non classé2 mois ago
Non classé2 mois agoEntretien du ministre de l’Agriculture et de l’Elevage sur la RTN: Au-delà de la maitrise de son cahier des charges, Mahaman Elhadj Ousmane confirme que l’autosuffisance alimentaire est réalisable !
-

 Santé2 mois ago
Santé2 mois agoSanté : Lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition des enfants au Niger : World vision lance la campagne ASSEZ/ENOUGH dans la région de Tahoua
-
Non classé4 mois ago
Communiqué de presse de la Banque Mondiale : L’accès à l’emploi et aux services publics sont les clés pour réduire les inégalités et la pauvreté en Afrique
